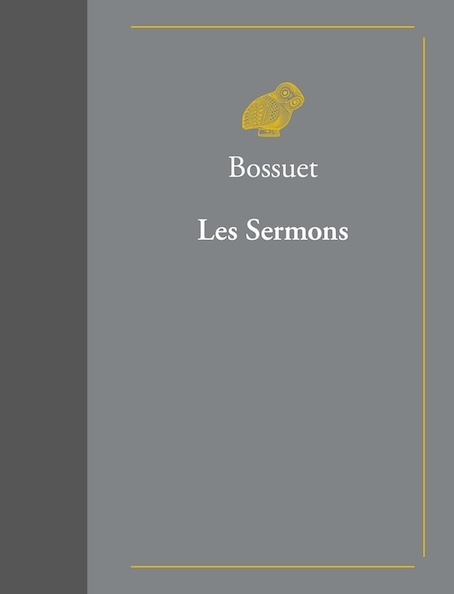Les Sermons, suivis des Oraisons funèbres et des Panégyriques, édition complète établie par Maxence Caron, préface de Renaud Silly o.p., Les Belles Lettres, 2026, livre relié, 18 x 25 cm, XLIV + 2450 pages.
Écouter un extrait ici
–
–
« Ouvrage fondateur de notre langue, monument de la littérature universelle, les Sermons de Bossuet n’ont fait l’objet d’aucune édition depuis un siècle. En voici l’intégralité. La gloire de ces Sermons tient un éclat auquel nulle autre œuvre ne saurait atteindre. En une relation analogue à celle de Cicéron avec le latin, l’œuvre oratoire de Bossuet constitue ce cœur historique où le génie d’un homme donne ses fondations définitives à l’excellence d’une langue. Ses tournures, ses inventions, son réexamen des usages, son souffle n’ont ainsi cessé d’inspirer les hommes – tandis que Littré illustre constamment de cette voix son Grand Dictionnaire. Puisant au fond des âges pour nourrir l’élévation du siècle, « l’Aigle de Meaux » conjoint le latin, le grec et l’hébreu au sein d’un verbe dont les éblouissantes substructions, par sa parole, sont devenues l’architecture de la nôtre. « Bossuet imite les prophètes, car prophète lui-même, dit Lamartine, il donne à sa langue la hauteur, l’autorité, l’antiquité et la divinité de l’Ancien Testament » : l’accent de l’hébreu et la force de ses images passent avec lui dans le français « qui se moule, colossal, sur le génie incorrect et démesuré de ce Michel-Ange de notre langue ».
Les Sermons sont l’œuvre d’une vie : Bossuet n’avait que 20 ans quand, bouleversant ses professeurs, il prêcha pour la première fois ; et il prêcha jusqu’à son dernier souffle. Il prononça ses sermons devant la cour aussi bien que devant ses humbles paroissiens. Placé aux plus hautes fonctions par le génie et non par l’intrigue, l’humilité et la force tissent sa personnalité : Mme de La Fayette le décrit ainsi « l’homme le plus doux et le plus franc qui ait jamais été mis à la cour », et l’admiration de La Bruyère lui donne la réputation d’un Père de l’Église.
Ces sermons suivent le temps liturgique ; il en est donc un pour chaque jour, pour chaque épreuve, pour chaque circonstance. Ils accompagnent l’existence. Ils prennent parfois la forme de « panégyriques » lorsqu’ils font le portrait d’une haute figure de sainteté. Et, à dix célèbres reprises, les sermons devinrent telle oraison funèbre dont les événements commandèrent le devoir. Que ce soit pour vivre, aimer ou souffrir, pour admirer ou mourir, la parole parfaite de Bossuet souffle. Car il est « le plus grand maître de la prose française : son langage contient tous les canons de notre parler. C’est une force, une clarté, une majesté qui baignent l’âme de lumière et la transportent de joie. » (Claudel) Portant en lui cet humanisme qu’il invente et pour qui l’universel entend aller d’Athènes à Jérusalem afin de renaître romain en France, Bossuet érige pendant le Grand Siècle une totalité inouïe au sein de laquelle notre langue reçoit d’un trait son foisonnement et sa rationalité, son émotion, sa précision et sa maturité. En avançant ne fût-ce que de quelques pas dans cette étendue, l’on comprend vite que la « langue de Molière » est, en réalité, celle de Bossuet. »