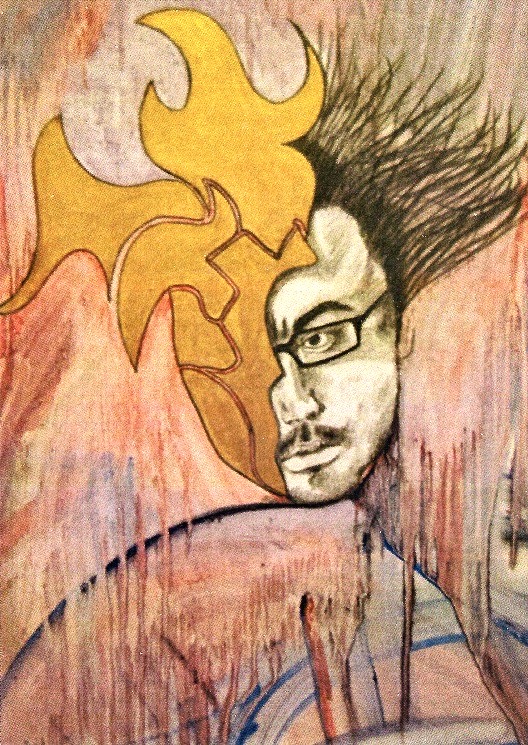Article de Sylvain Martin paru dans Sitaudis
(Cliquer ici pour lire l’article sur le site de Sitaudis)
–
« J’ai toujours passé pour bien étrange.
Je me suis placé hors la multitude, et je vis désormais loin de la servitude. »
Disons-le tout de suite, il faut une certaine témérité pour s’attaquer à ce « poëme épique et perpétuel » que nous livre ici Maxence Caron avec son Chant cathédral. 1103 pages composées de pas moins de 40 000 versets répartis en 40 chants. Et il ne s’agit là que des 40 premiers : 60 autres suivent, qui paraîtront, tout comme cette somme, aux Belles Lettres, en 2025. Rien que ça.
Si l’on ne connaît pas le phénomène Caron, on peut légitimement se demander de quelle plume jaillit un tel flot d’écriture. Mais si l’on a déjà eu l’occasion de croiser son nom, on n’en sera guère surpris. Car l’homme est un familier des superlatifs : agrégé de philosophie à 22 ans, puis docteur ès Lettres à 26, ce jeune prodige, adoubé par Claude Lévi-Strauss, Jean d’Ormesson et Mac Fumaroli (excusez du peu), signe à moins de trente ans l’un des ouvrages de référence sur Martin Heidegger : Heidegger. Pensée de l’être et origine de la subjectivité. Cet opus de plus de 1700 pages est couronné du prix de philosophie de l’Académie Française.
Suivront une monumentale tétralogie visant à la refonte complète « des arts de la pensée ». Ce seront les volumes de La Vérité captive, La Transcendance offusquée, Le Verbe proscrit et le Traité fondamental de la seule philosophie. L’ensemble couvrant plus de 5000 pages. Ajoutons à cela de nombreux textes épars (souvent très volumineux) touchant aussi bien à la philosophie qu’à la littérature ou à la musique.
Mais Maxence Caron ne se cantonne pas seulement à l’écriture (même si, compte tenu de l’ampleur de sa production, on se demande ce qu’il peut bien faire d’autre). Il est également éditeur. Son travail éditorial, pour l’ouvrage qui nous intéresse aujourd’hui, donne une clé fondamentale de son orientation : Bossuet, Catherine de Sienne, Saint-Augustin, Le Prince de Ligne, Léon Bloy et une anthologie Rivarol, Chamfort, Vauvenargues, entre autres. Et en effet, à lire ce « Chant » de Caron, on a le sentiment de naviguer entre les exégèses poétiques d’un Claudel, la puissante rhétorique d’un Bossuet ou les imprécations catholico-révolutionnaires d’un Péguy ou d’un Bloy.
Tâcher de donner un aperçu, ne serait-ce que partiel, de ce monument de poésie relève purement et simplement de la gageure. Parvenir au bout de l’ouvrage est en soi un exploit. Telle une longue traversée à travers une vaste steppe aux frontières indéfinies et à l’horizon incertain, le lecteur arpente, page après page, ce continent qui semble à la fois inconnu, mais aussi tout à fait familier. Comme surgit d’un temps que l’on pensait disparu à jamais, la forme et la pensée de Caron (sans parler de son catholicisme chevillé à chaque ligne) semblent à la fois relevé de l’antiquité littéraire la plus absolue en même temps que de la modernité la plus percutante. Mais ce voyage infini qu’est la lecture de ce « poëme », nous ne le faisons pas seul : en effet, Maxence Caron est là, semble-t-il, à chaque recoin de page, pour nous guider à travers cet océan. De Caron à Charon, il n’y a qu’une lettre. Et si c’est un voyage qui nous invite à sans cesse lever les yeux au Ciel pour contempler Dieu dans sa splendeur, nous n’en traversons pas moins l’Enfer du monde contemporain. Ce que Caron appelle « l’outremodernité ». Monde dans lequel « l’art conspire contre la beauté » et où « l’esthétique est (…) associée à toute bourse ». Dès lors, il nous faut à toute force éviter la noyade. Et Caron semble avoir composé à dessein son poème pour précisément y noyer le lecteur, tout en lui tendant régulièrement une main salvatrice. Comme s’il nous susurrait sans cesse : « Vous avez peur de vous perdre, et vous allez vous perdre, mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous aider. Appuyez-vous sur moi. Ayez confiance ». Et en effet, l’auteur est là, qui nous guide. On est dans son monde, dans sa pensée et dans sa langue. Une langue qui joue à foison des consonances néo-médiévales, des allitérations et des néologismes en tous genres, tel, à titre d’exemple, ce vers :
« Je voudrais que ta Parole ne prononçât pas trop vite ma défunction
Ni castigatifs les mots de la départition »
Ou cet autre :
« Aussi, tandis qu’en lalaïoutant dans le caverneux barytonal le monde se dévissait les tibias avec de la gélose pour mieux vouer ses verreries aux indéfinies siamoiseries du vide »
Impossible, ici, de viser à une quelconque exhaustivité. Le texte, de ce point de vue, foisonne de ces multiples trouvailles.
Rappelons-le : Maxence Caron est avant tout un philosophe. Et en l’occurrence ici, un philosophe déguisé en poète. Et qui plus est, un philosophe chrétien, par ailleurs fortement teinté de mysticisme. Mais avant tout un philosophe chrétien engagé, et en prise avec le monde. Ce monde qu’il a pourtant fui depuis des années maintenant (Caron vit en effet seul et reclus, quelque part dans le Vexin). Ainsi, à bien des endroits, son poème se transforme en manifeste de la pensée libre, et se teinte des accents que l’on trouvait déjà dans sa tétralogie philosophique. A mi-chemin entre Pascal et Descartes, nous trouvons ainsi quelques formules chocs :
« La Parole est transcendance et nous demande pourtant les mots. »
« Je pense donc Dieu est, Dieu est donc je pense. »
« Les personnes qui se sont appliquées trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes. »
Au lecteur à entreprendre lui-même le voyage et faire l’expérience de cette prose poétique, aussi riche que singulière et déroutante.
Ajoutons à cette idée de voyage la notion de méditation. C’est du moins le ressenti que l’on a à la lecture de ce poème fleuve. Le découpage en « chants » et en « versets » n’y sont sans doute pas étrangers. En effet, on pourrait très bien lire ce Chant cathédral comme on lirait chaque matin quelques versets de la Bible. Du reste, nous entrons bel et bien avec ce livre dans une « cathédrale de mots », un espace quasi sacré de la Parole où le recueillement et la méditation, pour ne pas dire la prière, sont de mise. Et c’est bien évidemment la volonté de l’auteur. Il faut donc entrer dans cet édifice avec la plus grande sérénité, monter sur la barque et prendre le large, en acceptant de se laisser guider par ce personnage fascinant, énigmatique, mystique, inquiétant, étrange, atypique, atemporel et, disons-le, unique, qu’est l’écrivain Maxence Caron.
De l’expérience de lecture qu’il nous propose, il donne lui-même la meilleure des définitions : « Je ne sais rien de plus esseulé que mon œuvre car il est véridique et neuf, car il est radical et d’un jeune être. »
Sylvain Martin